- NÉO-POSITIVISME
- NÉO-POSITIVISMELe néo-positivisme, ou positivisme logique, ne constitue pas à proprement parler une école, ayant à sa tête un maître et attachée à un dogme, mais plutôt une attitude philosophique définie à l’origine par un groupe (le Cercle de Vienne) et aujourd’hui largement diffusée et diversifiée, en particulier aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans les pays scandinaves.C’est en réaction contre l’idéalisme issu des grandes philosophies post-kantiennes, alors dominantes dans le monde germanique, que s’est formé à Vienne, dans les années trente, par la rencontre de quelques savants et philosophes d’un exceptionnel talent, le Wiener Kreis (Cercle de Vienne). En présence des progrès éclatants de la physique entre 1905 et 1930, comparés au déroulement incertain de la philosophie contemporaine, ils estiment que l’âge scientifique n’a pas la philosophie qu’il mérite. Cependant, aucune orthodoxie véritable ne lie les membres du groupe viennois, qui, dès 1931, commence à essaimer, avec R. Carnap et P. Frank, nommés à l’université de Prague pour occuper respectivement une chaire de philosophie des sciences de la nature et une chaire de physique. Des congrès internationaux, ayant pour thème l’«unité de la science », rassemblent alors autour des Viennois des penseurs venus d’autres horizons. Russell, Enriquez, Scholz participent au congrès de Paris (1935), G. Moore préside celui de Cambridge (1938); et celui de 1939 se tient à Cambridge, dans le Massachusetts. Déjà la montée du nazisme a précipité cette diaspora néo-positiviste. En 1938, Kaufmann, Menger, Gödel, Reichenbach sont aux États-Unis; Waismann et Neurath en Angleterre, où ils ont des disciples (Ayer); ils en ont aussi en Scandinavie (Petzäll, Joergensen, Kaila); et des logiciens de Varsovie (Ajdukiewicz, Kotarbinski) sympathisent avec certaines de leurs thèses. La multiplicité des points de vue, les critiques mutuelles, comme l’évolution des personnalités diverses, rendent vaines toutes les tentatives pour fixer les traits d’une doctrine; il est possible cependant de préciser certaines constantes, dont l’unité est celle d’une méthode de délimitation des problèmes philosophiques.En premier lieu, les néo-positivistes veulent rapprocher la philosophie et la science, en exorcisant de faux problèmes, qu’ils dénoncent sous le nom de métaphysique. Ils proclament, en deuxième lieu, leur attachement à l’empirisme, c’est-à-dire à une philosophie qui attribue à l’expérience tout le contenu de notre savoir. Mais ils veulent, chacun à sa manière, renouveler ce thème vénérable de la tradition philosophique et en préciser le sens à la lumière de l’actuelle pratique scientifique. Ils s’occupent enfin d’expliciter la fonction logique du langage, considéré comme source de tout l’aspect formel de nos connaissances.Si la critique de toute métaphysique qui voudrait se faire passer pour science justifie le nom de positivisme donné à cette attitude, il serait inexact et injuste de la réduire à ce thème, et d’ignorer le nombre et l’importance des problèmes philosophiques qu’elle a permis de poser avec rigueur.Science et philosophieLa «scientificité» (Wissenschaftlichkeit ) de la philosophie est l’une des idées maîtresses du néo-positivisme. Moritz Schlick l’interprète en un sens voisin de celui de Ludwig Wittgenstein: la philosophie a pour tâche d’élucider les propositions scientifiques, la science a pour fonction de les établir et de les vérifier. La philosophie est donc une connaissance positive en ce qu’elle prend pour thème le discours et la pratique scientifiques plutôt que des objets transcendant l’expérience. Mais, si la science elle-même est caractérisée comme représentation exacte du monde, la philosophie, acte d’élucidation, n’est pas une science, elle ne s’exprime pas dans le même langage que la science.La philosophie comme analyse du langageTel n’est pas, toutefois, le point de vue de tous les néo-positivistes, et en particulier de Rudolf Carnap, qui vise à faire de la philosophie une science parmi les sciences. Dans sa Logische Syntax der Sprache (1934), il veut montrer que les questions métaphysiques traditionnelles sont de pseudo-questions, dans la mesure où leur mystère repose sur la confusion et le mélange entre des expressions se référant aux objets du monde et des expressions se référant aux propriétés mêmes du langage. De telles pseudo-propositions apparaissent en particulier lorsqu’on énonce des propriétés syntaxiques d’un certain langage comme s’il s’agissait de propriétés d’objets réels. Par exemple, dire, avec Wittgenstein, que «le monde est la totalité des faits, non des choses» doit être correctement traduit par la proposition de syntaxe: «La science est un système de propositions et non pas un ensemble de noms.»Cette réduction opérée, la métaphysique se révèle comme expression inadéquate de la situation de l’homme à l’égard de la vie, autrement dit d’une «vision du monde»; il ne reste plus de la philosophie qu’une logique de la science, c’est-à-dire, pour Carnap, du moins à cette époque (1934), une «syntaxe logique du langage de la science». Plus tard, Carnap étendra cette thèse en identifiant la philosophie à une métathéorie générale de la science, à la fois syntaxique et sémantique, métathéorie dont l’influence reconnue de David Hilbert et d’Alfred Tarski l’avait conduit à chercher une exposition strictement formelle et exacte, à l’instar des sciences objectives.L’Encyclopédie et le physicalismeSans nécessairement adopter une définition aussi stricte de la philosophie comme science du langage scientifique, les néo-positivistes des années trente se sont mis d’accord pour entreprendre une mise en ordre de l’ensemble des énoncés scientifiques. Ce projet grandiose, renouvelé de Leibniz et des Encyclopédistes français, a explicitement pour visée d’unifier non le contenu de la connaissance, mais son langage. Il ne s’agit nullement de présenter un système, car, selon le mot d’Otto Neurath, «la complétude anticipée du Système s’oppose à l’incomplétude soulignée d’une encyclopédie». Il suffit de découvrir le langage qui permettra d’assurer à la fois un accord intersubjectif et une extension universelle. Pour Neurath et Carnap, ce langage est celui de la physique, ou plus exactement le langage qualitatif portant sur les «choses» (Dingsprache ). Les faits psychiques, en particulier, peuvent bien être traités par le psychologue d’une manière quelconque: ses propositions seront, en tout cas, traduisibles dans le langage physicaliste. Telle est la thèse; Carnap va même plus loin et propose comme but plausible pour le développement futur de la science, non pas seulement une unification de son langage, mais encore une réduction logique de ses lois à celles de la physique.Logique et langageSi l’entreprise encyclopédiste des néo-positivistes repose en définitive sur une unification du langage, c’est que la fonction logique de l’expression linguistique est pour eux essentielle.L’héritage wittgensteinienC’est avant tout du Wittgenstein du Tractatus logico-philosophicus (1921) qu’ils reçoivent sur ce point l’héritage. Pour ce philosophe, le langage est l’image du monde, et la science n’est rien d’autre que l’ensemble des propositions qui le décrivent. Chacune de ces propositions est l’image d’un «fait», qui s’analyse par liaisons entre faits élémentaires, ou «états de choses», à chacun desquels correspond une proposition élémentaire qui en est l’image et qui consiste en l’association d’un prédicat et des noms qui s’y rapportent. Ainsi, la logique, c’est-à-dire l’aspect a priori de la connaissance scientifique, se réduit à l’ensemble des contraintes qui règlent l’usage des liaisons propositionnelles et l’usage des prédicats. La logique n’est rien d’autre qu’une «grammaire» de la langue qui décrit le monde.Les néo-positivistes en retiendront que l’analyse du langage est la seule voie d’accès à la logique et que l’appareil de la logique symbolique est l’instrument que doit appliquer le philosophe à l’élucidation de tout énoncé quel qu’il soit.Syntaxe, sémantique, pragmatiqueL’importance de cette «nouvelle logique» est telle, pour les néo-positivistes, que l’association du formalisme linguistique et de l’empirisme constitue l’une de ses novations fondamentales.L’un des représentants de cette attitude, Charles W. Morris, introduira une triple distinction, devenue classique, dans cette analyse du langage à laquelle il donnera le nom général de «sémiotique», théorie des signes, à la fois science particulière et organon de toutes les sciences. Les signes ont des rapports entre eux en tant que signes: leur étude constitue la syntaxe; ils ont des rapports avec les objets et les faits auxquels ils renvoient: leur étude est la sémantique; des rapports enfin avec les personnes qui en usent, et leur étude est la pragmatique.Carnap, le premier, dès 1934, avait développé une syntaxe logique, qu’il considérait comme représentant à elle seule tout l’apport formel du langage. De ce point de vue, il déterminait un langage au moyen des règles de «formation» des énoncés propositionnels corrects, et au moyen des règles de «transformation» permettant de passer d’une ou plusieurs propositions à une proposition qui en est la conséquence. Carnap construisait ainsi à titre d’exemple deux langages de richesse croissante, dont le second seulement offrait la possibilité de développer l’arithmétique et l’ensemble des mathématiques classiques. Cette hiérarchie possible des langages le conduisait alors à énoncer un «principe de tolérance»: en matière de syntaxe – c’est-à-dire de logique –, «ce n’est pas notre affaire de formuler des interdits, mais d’arriver à des conventions». Tout système syntaxique est, en principe, valable, pourvu qu’il soit explicitement constitué et qu’on en puisse alors saisir les conséquences. Ainsi pouvaient être présentés sous un nouveau jour les problèmes relatifs au fondement des mathématiques et de la logique.En 1942, Carnap reconnaissait cependant, sous l’influence de Tarski, l’importance d’un autre point de vue, qui consiste à considérer les symboles dans leur rapport avec des désignations possibles. Un langage est alors défini au moyen de règles de formation, de règles de désignation et de règles de «vérité», qui indiquent à quelles conditions générales les propositions seront considérées comme vraies. Par opposition à la vérité de facto de tel ou tel énoncé apparaît alors une vérité logique de certaines combinaisons d’énoncés, indépendante des désignations particulières qui peuvent être assignées à leurs termes. Une définition sémantique de la notion de conséquence logique en résulte, non moins formelle que la définition syntaxique, mais certainement plus apte à faire comprendre les rapports du langage, de la logique et de l’expérience.L’empirismeL’expérience, en tant qu’elle se résout en sensations, telle est en effet, pour les néo-positivistes, la source unique du contenu de nos connaissances. Il n’y a pas de jugements synthétiques a priori; toute proposition valide a priori est analytique, c’est-à-dire que sa vérité ne dépend que des propriétés du langage. Il est vrai qu’un philosophe pourtant proche par ses origines du néo-positivisme, Willard Van Orman Quine, a poussé si loin la critique du langage que la distinction entre analytique et synthétique s’estompe, et que son empirisme tend vers un pragmatisme. Mais c’est là un exemple des voies divergentes qu’autorise l’attitude néo-positiviste; et la distinction de l’apport analytique du langage et de l’apport synthétique de la sensation demeure caractéristique de cette attitude.La construction logique du mondeCet empirisme présente un aspect constructif et un aspect critique. L’aspect constructif se manifeste, par exemple, dans l’œuvre de jeunesse de Carnap, Der logische Aufbau der Welt (1928). Le philosophe veut y «constituer» le monde, c’est-à-dire, à partir des données irréductibles de l’expérience individuelle, d’une certaine relation abstraite fondamentale, et de la logique symbolique, édifier un système de concepts tel que toute proposition se rapportant au monde puisse être adéquatement traduite par une proposition ne se rapportant qu’aux notions du système. Entreprise qui ne doit nullement être confondue avec les grandes synthèses idéalistes, car elle ne consiste pas à recomposer le monde.Il ne s’agit de rien de moins que de l’application à la totalité de l’expérience de la méthode employée par Bertrand Russell et Alfred N. Whitehead pour la construction logique des objets mathématiques. Un effort aussi systématique a été critiqué et repris d’une autre manière par N. Goodman (1951). Rudolf Carnap lui-même en a postérieurement souligné les défauts, et il abandonnera l’entreprise en faveur de la réduction physicaliste déjà mentionnée. L’Aufbau n’en demeure pas moins l’un des plus beaux monuments, trop mal connu, de la philosophie moderne. Elle a permis de poser de façon neuve et profonde le problème de l’abstraction, et de définir les limites d’une réduction logique de l’expérience.La vérification des énoncés empiriquesL’aspect critique de l’empirisme néo-positiviste se manifeste comme une mise en question de la vérification des énoncés d’expérience, considérée comme critère même de leur sens. Diverses solutions ont été présentées et vivement discutées à l’intérieur même du mouvement. Carnap et Neurath, dès 1931, proposent la théorie des «constats d’expérience» (Protokollsätze ). Toute vérification d’énoncé pourvu de sens reposerait sur le crédit accordé à des propositions élémentaires de la forme: «N, au temps t , au lieu x , a perçu ceci.» De tels énoncés portent donc sur des expériences explicitement individuées, dont il n’est pas possible de justifier en général le choix. Ainsi Neurath en vient à admettre que ce choix est purement conventionnel et qu’il n’existe aucun énoncé expérimental absolument primitif pour la construction de la science.Schlick, poursuivant l’analyse, proposera comme point de départ de toute science les «énoncés d’observation» (Beobachtungsaussage ), expressions d’une expérience non seulement individuée mais encore purement momentanée, que les Protokollsätze ne feraient que traduire en langage intersubjectif.K. Popper enfin, dans sa Logik der Forschung (1935), critiquant le psychologisme de la thèse de Schlick, propose comme points d’appui de toute vérification les «propositions de base» (Basissätze ) qui ont la forme d’énoncés «singuliers existentiels», et qui sont des «déterminations pensables de faits, dérivant d’une hypothèse». La vérification des énoncés empiriques complexes est alors un processus indéfini, auquel on ne met éventuellement un terme qu’en décidant d’être satisfait. On voit ici, une fois de plus, combien est grand l’attrait du conventionalisme.Propositions générales, induction et probabilitésSi les propositions empiriques singulières constituent bien la base de la science, les lois scientifiques ont néanmoins la forme de propositions généralisées, qu’une constatation empirique ne saurait directement vérifier. Aussi bien Popper a-t-il pu proposer de substituer au concept de vérification celui de «réfutation» (Falsifizierung ): une proposition générale peut être réfutée par une proposition existentielle unique, et cette possibilité sera prise comme critère de sa signification. Ainsi apparaît une dissymétrie fondamentale entre propositions générales et propositions singulières quant à leurs conditions de vérification. Des discussions soulevées sur ce point entre les néo-positivistes, ressort avec netteté une thèse centrale du nouvel empirisme: toute proposition synthétique et tout prédicat descriptif doivent se trouver dans un rapport déterminé avec ce qu’il est possible d’observer (V. Kraft); ce qui suppose, en fin de compte, que la vérification, ou mieux la confirmation, d’une proposition est relative à la grammaire logique du système d’expression auquel elle appartient, et qu’ont été déterminées avec exactitude les règles syntaxiques et sémantiques de cette grammaire, aux différents niveaux du langage scientifique.C’est de ce point de vue qu’il faut comprendre les importantes recherches auxquelles a donné lieu la notion de probabilité et celle de processus inductif. Quant à l’explication de l’idée de probabilité et au fondement de son calcul, deux thèses sont en présence chez les néo-positivistes: la thèse de la probabilité-fréquence, qui tente de donner une forme logique cohérente et exacte à l’intuition de suite aléatoire d’événements (Richard von Mises 1928, Hans Reichenbach 1934, et Popper 1935); et une autre thèse, qui remonte à Bernhard Bolzano (1837), John Maynard Keynes (1921) et Wittgenstein (1921), et qui interprète la probabilité comme liaison propositionnelle, comparable intuitivement à une implication affaiblie. Les travaux de Carnap ont approfondi et développé cette théorie (1950), dans laquelle le point crucial est la détermination d’une mesure pour les ensembles de propositions élémentaires servant à décrire un univers empirique.Situation du néo-positivismeLe programme du néo-positivisme est fort bien résumé par les deux néologismes dont usait Neurath en 1938: empiricalization et logicalization . Le succès qu’il a rencontré dans le monde anglo-saxon, et en particulier dans la société américaine de l’entre-deux-guerres, s’explique sans doute par la persistance d’une tradition empiriste et nominaliste, et la vigueur d’un certain courant pragmatiste dont Charles Sanders Peirce, plutôt que William James, serait le représentant. Il n’est pas étonnant dès lors que certains des philosophes d’expression anglaise parmi les plus vigoureux et les plus originaux soient de libres héritiers du néo-positivisme (Quine, Popper, Goodman). Il n’en a pas été de même en Europe continentale – sauf dans les pays scandinaves; en France, par exemple, l’influence des penseurs viennois, répercutée surtout par Rougier, a été presque aussitôt contrebattue et éclipsée par la vogue des philosophes de l’existence.L’impulsion donnée par le néo-positivisme aux recherches logiques et épistémologiques est cependant frappante, indépendamment même de toute adhésion à une orientation philosophique. Le cadre qu’il fournit à une interprétation de la science est en effet beaucoup plus souple et ouvert que ne le croient ses détracteurs. Quant au rejet radical de la métaphysique initialement proclamé et à l’assimilation de la philosophie à une science positive, l’évolution postérieure montre qu’il est possible, en restant fidèle à l’essentiel de l’attitude néo-positiviste, d’en retenir seulement le principe et les moyens d’une démarcation rigoureuse du domaine de la pensée non scientifique.néo-positivismen. m. PHILO Mouvement philosophique du XXe s., dit aussi positivisme logique, issu du cercle de Vienne (Schlick, Carnap, Reichenbach, Wittgenstein, etc.).⇒NÉO-POSITIVISME, subst. masc.PHILOS. Doctrine philosophique moderne, qui s'apparente au positivisme classique, auquel s'ajoutent de nouvelles tendances, en particulier l'intérêt porté à la logique et à l'analyse technique des problèmes. Synon. positivisme logique. Le néo-positivisme détermine nos informations à appréhender toute la vie économique, sociale, politique, alors que leurs réseaux statistiques n'en peuvent retenir que certains aspects quantitatifs (G. ELGOZY, Le Désordinateur, 1972 ds GIRAUD-PAMART Nouv. 1974).Prononc.:[
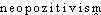 ]. Étymol. et Hist. 1908 (Lar. mens.). Formé de l'élém. néo- et de positivisme. Bbg. DUB. Dér. 1962, p.35.ÉTYM. Déc. 1908, néo-positivisme, F. Rauh, in Larousse Mensuel; de néo-, et positivisme.❖♦ Didact. École de philosophie des sciences qui ne reconnaît de sens qu'aux problèmes susceptibles d'être traités par une logique axiomatique; philosophie analytique et logique.0 Le néo-positivisme contemporain, issu du cercle de Vienne (avec ses deux sources particulières, le phénoménisme sensoriel de Mach et le logicisme…) et généralisé dans les pays anglo-saxons sous le nom d'empirisme ou de positivisme logique, marque un progrès évident sur l'épistémologie d'Auguste Comte : deux sources distinctes (…) de connaissances sont maintenant dissociées, la source expérimentale (…) et la source logico-mathématique, relevant (dans l'esprit de cette doctrine) d'une syntaxe et d'une sémantique communes à toutes les langues (…)J. Piaget, in Logique et Connaissance scientifique, Encycl. Pl., p. 48.
]. Étymol. et Hist. 1908 (Lar. mens.). Formé de l'élém. néo- et de positivisme. Bbg. DUB. Dér. 1962, p.35.ÉTYM. Déc. 1908, néo-positivisme, F. Rauh, in Larousse Mensuel; de néo-, et positivisme.❖♦ Didact. École de philosophie des sciences qui ne reconnaît de sens qu'aux problèmes susceptibles d'être traités par une logique axiomatique; philosophie analytique et logique.0 Le néo-positivisme contemporain, issu du cercle de Vienne (avec ses deux sources particulières, le phénoménisme sensoriel de Mach et le logicisme…) et généralisé dans les pays anglo-saxons sous le nom d'empirisme ou de positivisme logique, marque un progrès évident sur l'épistémologie d'Auguste Comte : deux sources distinctes (…) de connaissances sont maintenant dissociées, la source expérimentale (…) et la source logico-mathématique, relevant (dans l'esprit de cette doctrine) d'une syntaxe et d'une sémantique communes à toutes les langues (…)J. Piaget, in Logique et Connaissance scientifique, Encycl. Pl., p. 48.
Encyclopédie Universelle. 2012.
